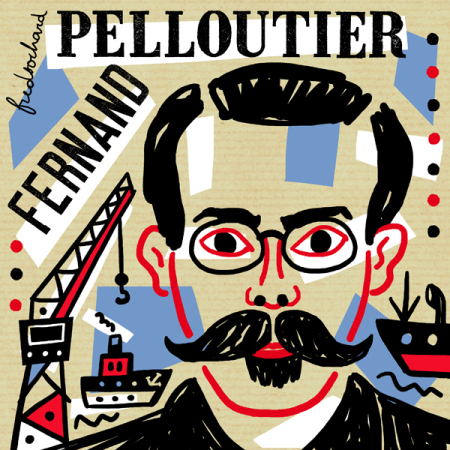Compagnes et libertaires, des femmes sans têtes ?
Marianne Enckell nous propose ici une version écrite de son Intervention lors des Journées Maitron, campus Condorcet, Paris, 3 décembre 2019.
Je parlerai ici non pas tant des militantes anarchistes que des « compagnes » des militants, trop souvent restées anonymes. Une réunion récente de collaborateurs du dictionnaire, Les Femmes de Normandie dans le Maitron, celles qui y sont et celles qui devraient y être, me semble pointer un problème qui ne concerne pas que les anarchistes.
On connaît évidemment nombre de couples militants parmi les anarchistes, on trouve même quelques images, pas nécessairement des plus habituelles :
Victorine B., la « morte vivante » de la Commune de Paris, et Gustave Brocher, pasteur devenu anarchiste et libre-penseur ; Alexandra Myrial, avant de s’appeler David Néel, et le musicien belge Jean Hautstont ; les sœurs Lily Rupertus, compagne de Christian Cornelissen puis de Jacques Reclus, et Frida Rupertus, compagne de Varlaam Tcherkesoff,
et quelques autres, même dans un jeu de familles recomposées : Anna Dondon et Raymond Callemin (ou plutôt René Valet), Barbe Le Clerch et Jules Bonnot (? plutôt Marius Metge), Rirette Maitrejean et Victor Serge…
Mais voici des histoires moins connues et moins décryptées.
En 1890, Eugénie Collot, tapissière parisienne, militait avec la Ligue d’affranchissement des femmes pour le droit de vote ; mais elle rejoignit bientôt le camp des abstentionnistes. Le 9 mars 1893, ceux-ci organisèrent une « cavalcade », affublés d’oreilles d’ânes pour moquer le suffrage universel ; Eugénie et ses copines portaient une pancarte : « Nous sommes des créatrices, nous voulons être des candidatrices ! » (Joli exemple des difficultés ou de l’ironie de la féminisation !)
Deux mois plus tôt, dans son journal Le Père Peinard, Emile Pouget s’était écrié : « Bonnes bougresses et bons bougres, le Père Peinard vous la souhaite bonne et heureuse ! »
Il est rare de lire des adresses aussi inclusives ; mais de sa compagne, « la mère Peinard », personne n’était encore parvenu à dénicher le nom d’état civil ; je l’ai trouvé tout récemment, par des recoupements sinueux.
Dix ans avant cela, en 1883, suite aux « pillages de boulangeries », Pouget avait purgé trois ans à la prison de droit commun de Melun. Il y reçut la visite de sa compagne, qui le seconda fidèlement pendant plus de vingt ans et fut de toutes les aventures du « père Peinard ». Lorsqu’il dut s’exiler à Londres vers 1894, c’était avec elle ; il se faisait d’ailleurs adresser sa correspondance au nom d’Emile Boiteaux, ou plus vraisemblablement Emile Boiteux.
Celle que les compagnons appelaient affectueusement « la mère Peinard » s’appelait en effet Stéphanie Boiteux, il est possible qu’elle ait été la locataire officielle du logis londonien. On sait peu de chose d’elle : née Marie Boisteux en 1855, morte à Paris en 1904. Aucune biographie de Pouget, à ce jour, ne mentionne son nom. C’est à Londres que le couple Pouget accueillit Augustin Hamon, qui avait pris pension chez eux ; et c’est grâce à une lettre de condoléances de Hamon à Pouget que j’ai pu trouver la date de la mort de sa compagne, puis le nom de Stéphanie dans L’Humanité, qui annonçait ses funérailles.
Et le petit-neveu d’Emile, Jean Pouget, a retrouvé une photographie dans les papiers de famille, qui avait pour seule légende « la première femme de Pouget ».
Les auteur·e·s de notices biographiques semblent peu se soucier d’identifier les compagnes anonymes, même celle qui « était également militante anarchiste » (Mohamed Saïl) ou celle qui « assistait souvent aux réunions du groupe » (Julien Aufrère). L’un échappe « à une extradition, grâce à l’admirable dévouement de sa compagne » (Parmeggiani) ; un autre « ouvre un petit magasin de fleuriste avec sa compagne » (Henri Bouyé).
Voyez ce que dit la biographie de Gaston Leval : « En 1924, alors qu’il venait de se marier, lui et sa compagne traversèrent l’Atlantique en passagers clandestins […] Le 21 juin 1938, il fut arrêté pour son insoumission en 1914-1918 et fut remplacé à SIA par sa compagne. » : mais ils se sont mariés en Espagne, où lui-même vivait sous un faux nom, comment diable les retrouver ? Sous quel nom s’est-il marié ? sous quel nom sont-ils revenus en France ?
Il vécut plus tard avec Marguerite Liégeois, mais ce n’était pas sa femme espagnole.
Je me suis livrée à un petit pointage. Dans le Dictionnaire des anarchistes, j’ai cherché les occurrences du syntagme « sa compagne » : il y en a environ 350 (pour tout le Maitron, il y en a près de 900). Pour ces 350 notices, on trouve 70 notices individuelles sur les femmes ou les compagnes évoquées ; on trouve 140 noms propres, dont plusieurs mériteraient une notice ; enfin, il y autant d’anonymes. Certaines ont un prénom, Rosa, Tounette, Gaby, Yvonne, Nanette… Elles ne sont évidemment pas toutes militantes ; mais je crois pouvoir affirmer que les auteurs n’ont pas pris la peine de creuser la question. J’ai fini par en retrouver un certain nombre, mais on est encore loin du compte.
Il n’y a guère que les auteures et les oratrices dont on connaît le nom et le pseudonyme, Fanny Clar, Alexandra Myrial, Séverine… Parfois elles en sont fières ! Pensez à la bonne Louise, à la mère Peinard, à Victorine B., à Séraphine, à Mimosa ! Et à à Louise Quitrime, qui composait de fort jolies chansons pour enfants sages :
Rondes pour récréations enfantines, vers 1889 (sur l’air de Ah vous dirais-je Maman)
Maintenant que nous savons
Que les rich’s sont des larrons,
Si notre pèr’, notre mère,
N’en peuvent purger la terre,
Nous, quand nous aurons grandi,
Nous en ferons du hachis.
L’inverse est rarissime : une notice sur Elisa Costenc a été rédigée en 2014, une notule sur son compagnon Charles Laborie n’a été publiée qu’avant-hier sur le site de Rolf Dupuy, militants-anarchistes.info/. Il va falloir la transférer sur le Maitron et compléter les balises.
Là, je ne vais plus parler seulement des anarchistes. Vous savez bien que les informations sont fréquemment fragmentaires, plus encore pour les femmes que pour les hommes : quand elles proviennent de rapports de police, on apprend une date de naissance mais presque jamais la date de la mort, que l’on trouve parfois dans les registres d’état civil ; et quand les hommes ne sont pas mariés, leurs compagnes n’ont souvent ni nom ni prénom, encore moins de dates de naissance. Combien de Madame Labouret, de femme Denhomme, de veuve Durand…
On trouve aussi trop de « pseudo-anonymes » dans les intitulés des notices : BARTHÈS (Veuve) [LAFONT ou LAFFON Magdelaine (Magdeleine, Madeleine), veuve BARTHÈS] ; DELCOMBRE (ou DELCAMBRE ?) (Veuve), née Thierry Palmyre, Ursule ; HAMEL (femme), née Best Augustine, Marie ; « veuve ou mère Moreau » (ALIX Berthe, dite), etc. C’est la terminologie des flics ! Il ne faudrait pas la reprendre aveuglément.
De Jeanne Hostens, on sait seulement qu’elle fut condamnée par contumace après la Commune ; la notice dit aussi qu’elle était mariée et mère de deux enfants, mais la qualifie toutefois de veuve. Elle a de la chance dans son malheur : la notice du Maitron intitulée HOSTENS (veuve), née Van de Poel, Jeanne, Marie, Jeannette, dite fille Ruelle, est référencée en outre sous De Poel, Van de Poel, Ruelle. Piètre consolation !
Quelques exemples de pistes à suivre : Les frères Maurice et Fernand Pelloutier épousent les sœurs Berthe et Maria Ridel ; qui sont-elles, d’où viennent-elles, que deviennent-elles ? Le 11 novembre 1890 à Genève, lors d’une réunion, un rapport de police relate que la femme de Gennaro Petraroja « proposa la formation d’un groupe de femmes anarchistes, disant que la femme est plus au courant de la misère que l’homme ». Elle s’appelait Teresina Blanco. Ils vécurent ensuite quelques années à Naples. Point final.
Peut-être, en effet, que les sources se trouvent dans les papiers de famille, la correspondance ; cela rendrait justice au titre de cette session, sur « le personnel et l’intime ». Mais en partie seulement, puisque les personnes qui nous intéressent sont des participantes actives au mouvement ouvrier et mouvement social.
Dans l’espace public, vous avez vu sans doute au printemps dernier d’éphémères plaques de rues roses : des militantes avaient lancé une action pour les renommer au nom de femmes, célèbres ou anonymes. On les a vues à Paris, par exemple à la rue Fessart dans le XIXe arr. (une occasion manquée : c’est dans cette rue qu’habitèrent Rirette Maitrejean et Victor Serge, et c’était aussi le siège du journal l’anarchie), à Lyon, à Perpignan, à Bruxelles, à Lausanne… À Genève, le collectif a eu la bonne idée de me demander des suggestions, et les autorités de la Ville la bonne idée de faire durer ces noms une année au moins : on y trouve donc non seulement, grâce aux notices du Maitron, Virginie Barbet, Minnie Lecompte ou Victoire Tinayre, mais aussi Ruth Bösiger, dite Coucou. C’est surtout André Bösiger, son mari, qui est répertorié, qui a écrit ses mémoires avec l’aide d’Alexandre Skirda ; mais Coucou était toujours à ses côtés. (Bernard Baissat, qui a filmé André Bösiger à Paris il y a vingt-cinq ans, me dit qu’il a appris aujourd’hui grâce à moi l’existence de Coucou…)
Il en va peut-être de même dans les dictionnaires biographiques de violonistes ou de communistes. Il reste quantité de femmes sans nom, sans tête. Faut-il s’en plaindre ? Plutôt creuser, lire des correspondances, chercher des pistes, faire des hypothèses, publier des résultats approximatifs. Reprendre les allusions à des couples militants, et doubler la notice. Ajouter des balises ! Redonner vie à ces femmes anonymes, sans lesquelles le mouvement anarchiste, ou communiste, ou violoniste n’aurait pas été ce qu’il est.
Merci à elles toutes.