

FURET François
Par Patrick Garcia
Né le 27 mars 1927 à Paris (VIIe arr.), mort le 12 juillet 1997 à Toulouse (Haute-Garonne) ; militant communiste à la fin des années quarante et pendant les années cinquante, un temps militant du PSU ; collaborateur du Nouvel Observateur ; président de l’EHESS (1977-1985), historien.
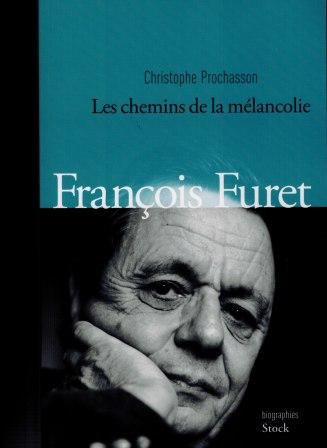
François Furet naquit à Paris dans un milieu bourgeois – son père, Pierre Furet, exerçait la profession de banquier – ouvert aux idéaux de gauche. Son grand-père paternel avait été dreyfusard, son grand père maternel, Alfred Monnet, sénateur républicain et son oncle, Georges Monnet, député socialiste et ministre de l’Agriculture dans le premier gouvernement Blum. Il étudia au lycée Janson-de-Sailly et participa à des activités dans la Résistance dont il fit parfois état, à Paris dans les rangs du Front national étudiant à partir de février 1944, puis à la suite de l’arrestation de l’un de ses camarades, dans le Cher, dans les FFI, à partir de juillet 1944. À la fin des années 1940, des ennuis de santé le conduisirent au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère). François Furet obtint l’agrégation d’histoire en 1954. En 1956, il devint attaché de recherches au CNRS. Il n’acheva jamais son doctorat sur la bourgeoisie parisienne au temps des Lumières (intitulé de facture très « labroussienne ») dont le sujet le conduisit notamment à travailler avec Adeline Daumard (Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle, Paris, Colin, 1961).
En 1961 il entra comme sous-directeur d’études à la VIe section de l’École pratique des hautes études. Il fut élu directeur d’études en 1966, puis présida cet organisme (devenu en 1975 École des hautes études en sciences sociales) de 1977 à 1985. Son itinéraire intellectuel s’identifia donc, dans un premier temps, avec la revue les Annales, dont il défendit la rupture avec l’histoire événementielle (« Problèmes des sciences contemporaines », 1975) et le recours aux procédures quantitatives (« L’histoire quantitative et la construction du fait historique », 1971) considérant l’histoire sérielle comme « une révolution de la conscience historiographique ». Il se repositionna pourtant, dès le début des années 1980, dans la dynamique de ses travaux sur la Révolution, “en marge des Annales” (« Histoire et sciences sociales », 1981 repris en préface de L’atelier de l’histoire), critiquant à la fois l’histoire « qui s’appelle elle-même nouvelle » – dont il déplorait « l’épistémologie de l’émiettement » – et l’histoire économique et sociale inspirée des problématiques d’Ernest Labrousse : il entendait, pour sa part, promouvoir une nouvelle histoire politique qui affirmait l’autonomie du politique par rapport au social – voire envisageait le politique comme l’entrée la plus englobante pour étudier les sociétés. C’est dans cette optique qu’il créa l’Institut Raymond-Aron qui rassemblait des chercheurs désireux de refonder les études politiques en France – dont Marcel Gauchet, Pierre Manent ou Pierre Rosanvallon. Il le dirigea jusqu’en 1992.
Parallèlement à cette carrière universitaire et non sans interaction avec les problématiques qu’il a adoptées et les sujets auxquels il se consacra, François Furet fut un homme d’engagement politique. En février 1949, il adhéra aux Combattants de la paix, au Parti communiste français, où il suivit aussitôt une école de section, et rejoignit en mars l’UJRF (la jeunesse communiste). Sur cet engagement, comme du reste sur l’ensemble de sa vie, il resta toujours discret sinon pour dire qu’il s’était inscrit au Parti communiste « comme les autres » – son frère Jean et sa sœur Hélène suivirent le même parcours – et expliquer que, pour l’intellectuel qu’il était, l’engagement communiste permettait de « retrouver un lien mythique avec le peuple, avec la classe ouvrière » avec « en prime, une explication globale et exhaustive de la société » (Le Nouvel Observateur, 20 novembre 1978 repris dans Un itinéraire intellectuel, 1999).
Son adhésion, qu’il qualifia ultérieurement d’« adolescence tardive dans les rangs du PC » (ibid.), est restée valorisée comme un puissant ciment générationnel. Cette appréciation rétrospective ne doit cependant pas conduire à conclure à une quelconque tiédeur – son zèle à faire adhérer ses proches est attesté par plusieurs témoignages. Au reste les deux fiches biographiques qu’il remplit en 1949 et 1952, conservées dans les archives du PCF, dressent le portait d’un militant déterminé bien que n’ayant occupé que des fonctions de direction peu importantes. En 1949, il y apparaît comme « secrétaire de la cellule de Droit ; membre du secrétariat de rédaction de Clarté – le journal de l’Union des étudiants communistes – et membre de la sous-commission étudiante à la fédération » de le Seine du PCF. À cette époque, sa candidature fut examinée pour un poste de permanent de l’association France-Pologne, mais finalement écartée. En 1952, sa fiche biographique indique qu’il fut membre du bureau de section de Saint-Hilaire du Touvet en 1950, responsable à l’éducation, secrétaire de l’association des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet en août 1950 puis vice-président de l’association générale des étudiants en sana (UNEF) et qu’il devînt membre du conseil d’administration de cette dernière organisation. Y ayant accompli un « très bon travail » il fut même proposé comme secrétaire de la délégation d’étudiants qui se rendit trois semaines en URSS en 1952 (décision approuvée par le secrétariat du comité central en août 1952 mais qui ne semble pas avoir été effective). Des indications contradictoires de sa part datèrent a posteriori sa rupture de 1954 ou 1956. Son dossier comporte toutefois un compte rendu de discussion sine die établi par Paul Chareton, responsable du suivi des intellectuels communistes parisiens et des questions universitaires dans les années 1957-58, qui atteste qu’il fit alors amende honorable d’être entré en contact avec le Club de la gauche, qui rassemblait des intellectuels proches des milieux mendésistes et de la revue Les Temps modernes et qui participa à la fondation du PSA (1958) puis du PSU (1960). Ce contact, qui valut à Henri Lefebvre, notamment, l’exclusion en 1958 pour « activité fractionnelle caractérisée », ne semble pas avoir été retenu à charge. Le rapport que l’on peut vraisemblablement dater de la fin 1957 ou du début 1958 – le Club de la gauche est officiellement créé au printemps 1958 – ne signale, en effet, qu’un seul point de divergence assumé : “certaines positions idéologiques concernant une discipline ‘l’Histoire’”. Il poursuivait : « Le camarade Furet demanda que les historiens puissent se réunir, pour examiner avec des représentants de la direction du Parti certaines questions qui méritent discussion, par exemple : le fait historique, l’objectivité en histoire, etc… » .
Après son départ du PCF – au terme d’un désengagement sans doute plus lent et plus complexe que François Furet n’a voulu par la suite le reconnaître publiquement – il fut proche du PSU et resta durablement dans la mouvance de cette « deuxième gauche » anti-totalitaire qui redécouvrait progressivement les mérites du libéralisme. Il devint dès 1958 (d’abord sous le pseudonyme d’André Delcroix), un collaborateur régulier de France-Observateur puis, jusqu’à sa mort, du Nouvel Observateur. Ce goût affirmé pour le journalisme – somme toute singulier dans sa génération – ne s’est jamais démenti puisqu’il a, en outre, collaboré par la suite tant au Débat qu’à Commentaires. Après mai 1968 il fut conseiller d’Edgar Faure quand celui-ci entreprit la réforme du système universitaire français. La création, en 1982, avec Pierre Rosanvallon, de la Fondation Saint-Simon, lieu de rencontre où des universitaires, des hommes politiques et des responsables économiques envisageaient les problèmes contemporains dans une optique libérale, participa de l’effort de refondation idéologique de la gauche non-communiste. En 1988, avec Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, il tira les conséquences politiques de ses positions historiographiques sur l’achèvement de la Révolution française en publiant, sous l’égide de cette fondation, La République du centre. La fin de l’exception française : y était prônée une rupture assumée avec l’imaginaire de la conflictualité à l’œuvre, selon lui, depuis la Révolution, ceci afin de dégager les voies d’une vie politique nouvelle conforme au “droit commun” des démocraties libérales qui privilégierait, contre les cultures de la radicalité, la recherche du consensus. Cette préoccupation constante des questions politiques contemporaines – qui conjuguait après la rupture avec le parti communiste “un intérêt intellectuel profond [et] un désinvestissement affectif” (Nouvel Observateur, Entretien du 20 novembre 1978) – s’inscrivait en résonance avec son travail d’historien qui le conduisit des Lumières et de la Révolution française à la Révolution russe et au communisme.
C’est en 1965 que François Furet consacra son premier ouvrage à la Révolution française. Cette synthèse écrite avec Denis Richet, richement illustrée et destinée au grand public, n’en fit pas moins date dans le milieu des historiens. En effet, à rebours de l’historiographie économique et sociale qui dominait en Sorbonne, contre la tradition qui, de Jean Jaurès à Albert Soboul en passant par Ernest Labrousse, lisait 1793 et la dictature de Salut public comme un approfondissement de la Révolution, une “anticipation” (Labrousse) des revendications et des conquêtes du mouvement ouvrier et socialiste, Furet et Richet analysaient le processus qui avait conduit de l’échec du compromis constitutionnel à la Terreur comme un “dérapage” de la Révolution du fait de “l’irruption violente des masses”. Ils qualifiaient l’année 1790, quand la révolution libérale parut s’imposer, d’“année heureuse”. L’ouvrage provoqua une violente polémique. Il fut qualifié de “révisionniste” par les tenants de l’histoire économique et sociale et notamment Claude Mazauric qui se posa en défenseur de l’interprétation sociale de la Révolution et, à travers elle, d’une lecture marxiste de l’histoire (Sur la Révolution française. Contributions à l’histoire de la révolution bourgeoise, Éditions sociales, 1970).
Ce furent précisément cette interprétation et cette lecture de l’histoire qui furent la cible des articles que François Furet publia à partir de 1971 et qui furent réunis (assortis d’un long article introductif intitulé « La Révolution française est terminée ») sous le titre Penser la Révolution française en 1978. Cette fois l’historien ne proposait pas de récit de la Révolution, il se livrait à une critique de l’historiographie classique qualifiée de « vulgate marxiste » ou de « catéchisme révolutionnaire ». En réponse à ceux qui avaient critiqué la notion de « dérapage » il réfutait ce qu’il dénommait « l’excuse débile des circonstances », interprétant la Terreur non comme une réponse conjoncturelle à une situation exceptionnelle mais comme un système. Ancrant sa réflexion dans l’actualité immédiate il invoquait l’œuvre de Soljenitsyne et, retournant la filiation entre jacobins et bolcheviks, il soutenait : « le Goulag conduit à repenser la Terreur en vertu d’une identité de projet ». La Révolution étant terminée il proposait de rompre avec l’ « historiographie commémorative » et de mettre cet événement à distance, comme un “objet froid”. Il envisageait celle-ci d’abord comme un phénomène politique, une « perpétuelle surenchère de l’idée sur l’histoire réelle » et prônait une histoire délaissant le point de vue des acteurs trop marqué, selon lui, par l’ « illusion » de la rupture. À rebours de la tradition historienne en pareil cas, il ne proposait pas un retour à l’archive mais une relecture des interprétations auxquelles la Révolution avait donné lieu – particulièrement celles qui sont antérieures à la Révolution russe. Le détour historiographique inauguré par l’étude des œuvres de Tocqueville et de Cochin resta une marque du travail de Furet sur la Révolution ainsi que la posture “critique” qu’il adopta alors.
Entre Penser la Révolution française et le Bicentenaire (1989) Furet poursuivit son travail critique en montrant que la Révolution et l’appréciation portée sur la Terreur ne formaient pas seulement frontière entre la gauche et la droite mais aussi à l’intérieur même de la gauche. Il étudia ainsi la polémique soulevée par La Révolution d’Edgar Quinet (1865) quand celui-ci avait proposé de dissocier 1789 et 1793 considérant que « la Terreur a été le legs fatal de l’histoire de France » et la négation de la Révolution. En 1988 il dirigea avec Mona Ozouf un Dictionnaire critique de la Révolution française qui apparut comme l’expression d’une nouvelle école tandis qu’il publiait en son nom propre une Révolution française de Turgot à Ferry qui s’étendait de 1770 à 1880 soit, dans une perspective tocquevillienne, une révolution qui éclatait après que les principaux changements sociaux furent advenus et qui ne parvint au port que lorsque les questions de l’égalité devant la loi et de l’égalité sociale furent disjointes.
L’après 1989 ouvrit un nouveau chantier dont il est raisonnable de penser qu’il était une préoccupation personnelle constante de l’historien : celui du communisme. L’URSS ayant disparu, il se proposa de faire histoire de l’imaginaire communiste. Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle (1995) lui permit de livrer sa propre lecture du XXe siècle. « Son » XXe siècle est dominé par l’affrontement de deux idéologies, le nazisme et le bolchevisme, qui prennent racine dans le même événement matriciel – la Première Guerre mondiale – et partagent la même haine du libéralisme. Phénomènes religieux, leur face à face a comme dévoré le siècle. Sous sa plume, l’antifascisme apparait comme un leurre puisque totalement instrumentalisé par le communisme. Pire encore, intellectuellement, la posture antifasciste interdit de comprendre le siècle en disqualifiant d’avance la comparaison entre nazisme et communisme et en invalidant le recours au concept de totalitarisme. Poursuivant sur ce chantier il aurait dû être le préfacier du Livre noir du communisme (S. Courtois et alii, Robert Laffont, 1997) – livre au demeurant dédié, à sa mémoire. À la suite de la publication du Passé d’une illusion il engagea un échange épistolaire avec Ernst Nolte dans lequel il saluait l’importance de l’œuvre de ce dernier tout en récusant la thèse de l’historien allemand selon laquelle le nazisme ne fut qu’une réaction de défense face au communisme et le goulag la matrice d’Auschwitz. Il entreprit, dans le même temps, la rédaction avec Paul Ricœur d’un livre à deux voix autour du Passé d’une illusion qui ne sera pas achevé en raison de son décès.
Professeur permanent à l’université de Chicago à partir de 1985, sacré par les médias « roi » d’un Bicentenaire dans lequel il avait refusé tout investissement institutionnel, élu à l’Académie française en 1997, François Furet a été reconnu de son vivant comme l’une des grandes figures de l’historiographie française contemporaine. La notion d’ « énigme », qu’il a utilisée aussi bien pour rendre compte du déroulement de la Révolution française, de la vie politique française ou encore du succès de l’idéologie communiste comme de sa désagrégation, traduit la singularité de cette approche à la fois attentive à la puissance de l’événement et pétrie d’inquiétude – voire peut-être désarmée sur le plan conceptuel – face aux surprises de l’histoire. Envisagée de la sorte, la centralité dans son travail d’interprétation de l’histoire des notions d’énigme et d’illusion n’est-elle pas aussi le contre-point à la lisibilité d’une histoire téléologique à laquelle il avait adhéré dans sa jeunesse ? À distance, sa marque reste forte même si on a peine à discerner les contours d’une école qu’il aurait fondée. Il ressort de ses écrits une vision mélancolique de l’histoire que semble accentuer le sentiment que les combats qu’il a livrés ont été victorieux, voire une nostalgie des débats politiques dont il a lui-même annoncé la forclusion. « Telle est la toile de fond mélancolique de cette fin de siècle. Nous voici enfermés dans un horizon unique de l’Histoire, entraînés vers l’uniformisation du monde et l’aliénation des individus à l’économie, condamnés à en ralentir les effets sans avoir de prise sur leurs causes » écrivait-il ainsi à Ernst Nolte le 5 janvier 1997.
Par Patrick Garcia
ŒUVRE : « Structures et relations sociales à Paris au XVIIIe siècle », avec A. Daumard, Cahiers des Annales, Armand Colin, no 18, Paris, 1961. — Le mouvement du profit en France au XIXe siècle, avec J. Bouvier et M. Gillet, Mouton, 1965. — La Révolution française, avec D. Richet, Hachette-Réalités, Paris, 1965-1966, rééd. Pluriel, 1986. — Livre et société dans la France du XVIIIe siècle (en collaboration), Mouton, 1977. — Lire et écrire, l’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, 2 vol. avec J. Ozouf, Minuit, 1978. — Penser la Révolution française, Gallimard, 1978, 2e éd. revue, 1983. — L’atelier de l’histoire, Flammarion, 1982. — Terrorisme et démocratie, avec A. Liniers et P. Raynaud, Fayard, 1985. — Marx et la Révolution française, avec L. Calvié, Flammarion, 1986. — La gauche et la Révolution française au milieu du XIXe siècle, Hachette, 1986. — Edgar Quinet et la question du jacobinisme, 1865-1870, Hachette, 1986. — La Révolution de Turgot à Jules Ferry, 1770-1880, Hachette, 1988. — La République du Centre, la fin de l’exception française, avec P. Rosanvallon et J. Julliard, Calmann-Lévy, 1988. — Dictionnaire critique de la Révolution française, en co-direction avec M. Ozouf, Flammarion, 1988. — The Transformation of Political Culture, 1789-1848 (vol. III : The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture), en co-direction avec M. Ozouf, Pergamon Press, Londres, 1989. — Les orateurs de la Révolution, t. I : Les Constituants, avec R. Halévi, Gallimard, 1989. — L’héritage de la Révolution française, Hachette, 1989. — Le siècle de l’avènement républicain, Gallimard, Paris, 1993. — La Gironde et les Girondins, en co-direction avec M. Ozouf, Payot, 1993. — Le passé d’une illusion essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Robert Laffont / Calmann-Lévy, 1995. — La monarchie républicaine. La Constitution de 1791, avec R. Halévy, Fayard, 1996. — Fascisme et communisme avec E. Nolte, Plon, 1998. — Un itinéraire intellectuel. L’historien journaliste de France-Observateur au Nouvel-Observateur (1958-1997), édition établie et préfacée par M. Ozouf, Calmann-Lévy, 1999. — La Révolution française, réunion d’ouvrages et d’articles de François Furet avec une préface de M. Ozouf, Quarto Gallimard, 2007. — Penser le XXe siècle, réunion d’ouvrages et d’articles de François Furet, édition établie par M. Ozouf, préfacée par P. Hassner, Bouquins, Laffont, 2007.
SOURCES : Presse et préface des livres cités à ŒUVRE. — Arch. comité national du PCF (notes de Paul Boulland). — Pierre Statius et Christophe Maillard (sd), François Furet. Révolution française, Grande Guerre, communisme, CERF, 2011. — État civil de Toulouse.
Parue après la rédaction de cette notice : Christophe Prochasson, François Furet. Les chemins de la mélancolie, biographie, Stock, 2013.

